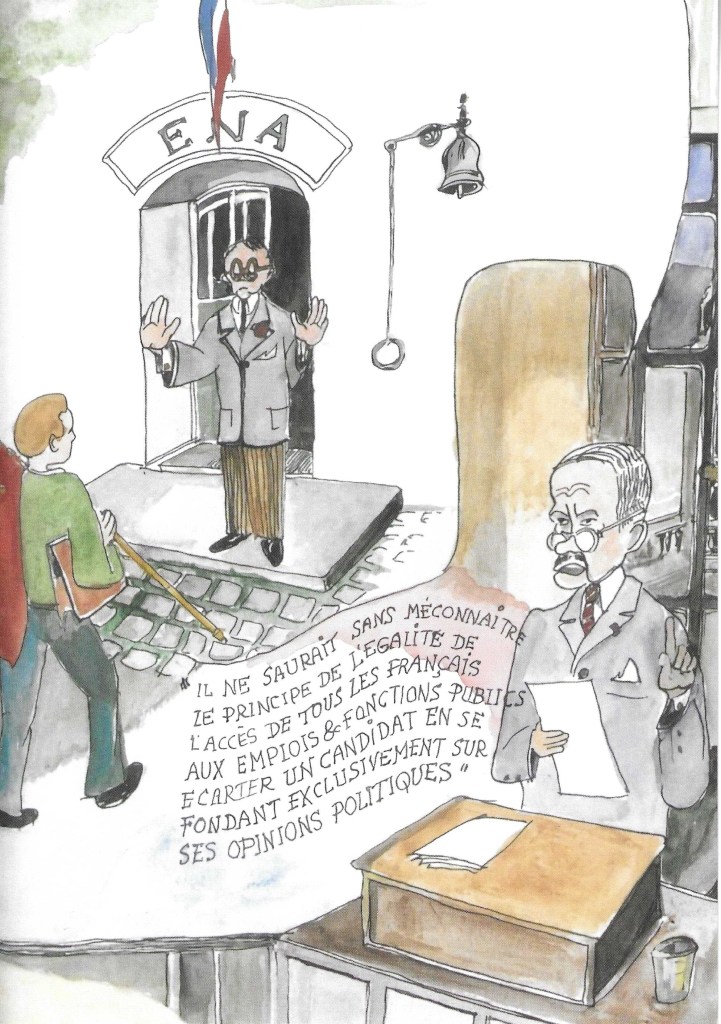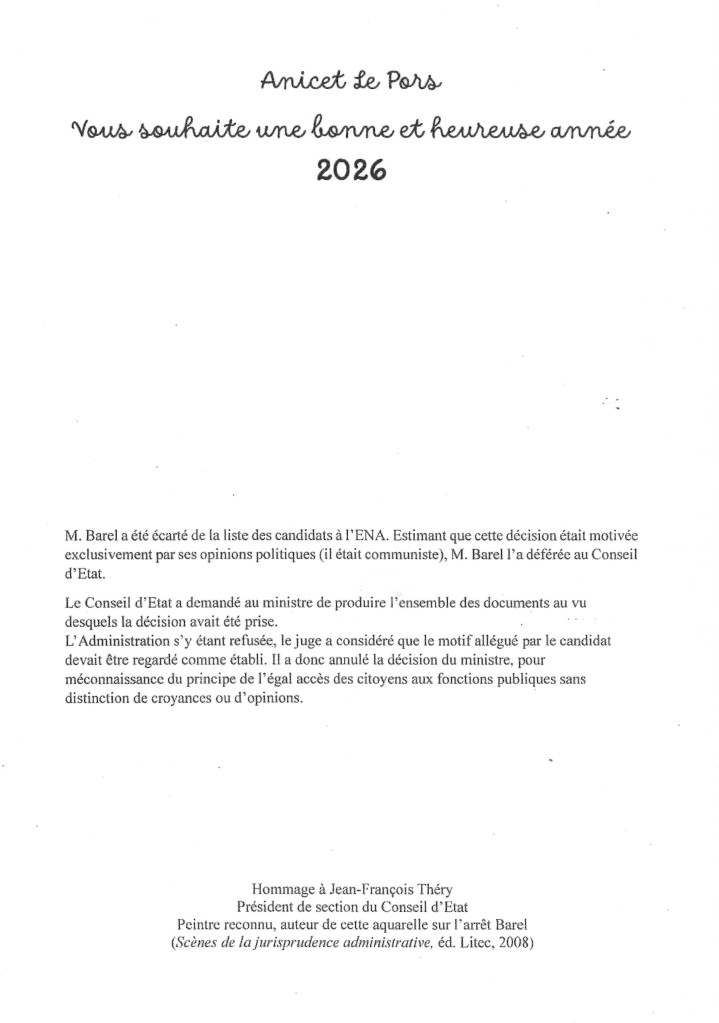l’Humanité le 11 février 2026
Tribune
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars. Les services publics sont au cœur de ce scrutin, à fin de permettre l’application de principe sur l’ensemble du territoire national et la libre initiative locale en vertu de l’unité et de l’indivisibilité de la République
L’importance des élections municipales tient au fait que c’est au niveau de la commune que se conjuguent les légitimités de l’élection, de la loi et de la responsabilité individuelle, le cadre dans lequel peuvent se rencontrer quotidiennement l’élu, le fonctionnaire et l’usager citoyen pour discuter du bien commun. C’est une chance pour la France de disposer d’autant de communes que l’ensemble des autres pays de l’Union européenne. Reste cependant à préciser la nature des relations que l’on veut établir entre elles les communes par accords de coopération et de mutualisation afin de parvenir ensemble à la meilleure efficacité sociale. Doivent également être précisés les rapports que les communes doivent nécessairement établir avec le niveau départemental, sans qu’interviennent excessivement les injonctions du pouvoir central, mais que soient respectées les règles d’un aménagement rationnel du territoire. Plus généralement encore la place de la commune doit être située dans une conception des institutions qui permette à la fois l’énoncé de principe rien applicables dans l’ensemble de la nation et la libre initiative des instances locales. Ou comment rendre compatibles deux principes contradictoires de la constitution de la Ve République : l’unité et l’indivisibilité de la République (article 1er), et la libre administration des collectivités territoriales (article 72). Un débat jamais achevé.
C’est ainsi que l’alternance politique de 1981 ouvrant la voie d’une démocratisation profonde des collectivités territoriales permettait d’envisager le renforcement des garanties statutaires des personnels. La solution finalement retenue respectait les deux principes contradictoires précités (unité et diversité) dans le cadre d’une fonction publique unifiée dite « à trois versants » (État, collectivités territoriales, établissements publics hospitaliers). Elle avait deux conséquences essentielles : d’une part, l’affirmation de la dignité des « communaux » devenus fonctionnaires de plein droit, d’autre part, la reconnaissance d’une véritable fonction publique territoriale. La réforme fut soutenue par l’ensemble des organisations syndicales. Des maires, craignant pour leurs prérogatives émirent des réserves qui s’atténuèrent au fil du temps. La réforme fit l’objet de nombreuses attaques frontales et de centaines de dénaturations au cours des quatre dernières décennies, mais le fait dominant est l’extraordinaire dynamisme dont a fait preuve la fonction publique territoriale durant la période. Regardée au début comme le « maillon faible » de l’architecture juridique retenu, elle est aujourd’hui une référence pour la fonction publique tout entière, prouvant par-là que la prise en compte rationnelle de principes contradictoires pouvait être à l’origine d’une dialectique démocratique constructive.
La réflexion doit aussi être portée jusqu’aux plus hauts niveaux politiques de la République, là où se conçoit et tente de se définir l’intérêt général finalité du service public. Mais de quoi l’intérêt général est-il le nom ? Ce n’est pas l’optimum social de la théorie néoclassique chère aux libéraux, ni la justice redistributive terrain des socio-démocrates, ni l’exclusif intérêt de classe du marxisme. À la fin du XIXe siècle, l’école française du service public avait tenté une théorisation du concept de service public incluant l’intérêt général (mission d’intérêt général, personne morale de droit public, juge et droit administratifs, couverture par l’impôt et nous par les prix). L’un de ses représentants, Léon Duguit, considérait même que l’État était en fait une « coopération de services publics Cette période a pu être regardée comme l’«âge d’or » du service publics ». Aujourd’hui, on assiste à une croissance beaucoup plus rapide des besoins fondamentaux que celle des moyens budgétaires destinés à leur satisfaction. Cet écart croissant entre besoins et moyens entraîne un mécontentement de la population devant cette défaillance en même temps que que s’ouvrent d’importantes opportunités lucratives en faveur d’intérêt privé. Les services publics apparaissent ainsi à notre époque comme le moyen structurant d’une recomposition politique et social. Les collectivités locales en raison de leur proximité aux besoins et d du caractères fédérateur de leur intervention sur le champ le plus large on évidemment un rôle déterminant a joué dans ce contexte.
Anicet Le Pors
Conseiller d’Ettat honoraire
Ancien ministre PCF
de la Fonction publique